|
Nouvelles du SPPEUQAM – 23 janvier 2025 ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏
| |
Info-Direction du 21 janvier : Le SPPEUQAM rétablit les faits

|
|
Pour faire suite au message de la Direction envoyé aux personnes chargées de cours le soir du 21 janvier, le SPPEUQAM tient à rétablir les faits à l’intention de ses membres. À la suite de la séance de négociation du 21 janvier, le conciliateur a en effet annulé la rencontre suivante prévue le 23 janvier. Il faisait le constat qu’à ce moment aucune des deux parties n’envisageait de contre-propositions sur les dernières offres déposées par l’autre sur les 3 priorités des membres : la limitation de la taille des groupes-cours; le maintien de l’offre en présence et la compensation de la surcharge en préparation et encadrement des cours en ligne. Il ne s’agit pas d’une fin de la négociation; celle-ci pourra reprendre dès que l’impasse constatée pourra être débloquée par le dépôt d’une contre-proposition. Le Comité de négociation se rend bien évidemment disponible à tout moment pour retourner en conciliation. Rappelons brièvement ce qui a mené à cette situation. • Depuis près d’un an, l’employeur ne proposait aux membres aucune avancée par rapport à la négociation 2020-2022 qui inclut toutefois une lettre d’entente s’appliquant jusqu’à la conclusion de la négo actuelle. Et les propositions patronales allaient même en deçà des conditions de cette lettre. En décembre, l’employeur a pour la 1re fois reconnu que les membres n’accepteraient pas de perdre leurs acquis. • Nous avons exploré avec le comité patronal de nombreuses avenues sous forme exploratoire, ce qui nous empêchait de vous donner le fin détail des échanges. Maintenant que la Direction a pris la décision de révéler publiquement la teneur de nos discussions, nous avons pu présenter en Conseil syndical élargi du 22 janvier les divers compromis qui ont été envisagés jusqu’ici, bien que rien n’ait été convenu encore comme nous sommes toujours à l’étape de pourparlers. • L’Info-Direction faisait mention de 12 points, mais sachez que la potentielle obtention de la majorité de chacun de ces éléments était conditionnelle à l’abandon d’autres demandes des membres et que des limites importantes liées à chacun de ces points ont été omises dans la communication patronale. Nous en brossons ici de grandes lignes en axant sur les priorités des membres. • La Direction prétend avoir soumis en janvier une hausse de 42,9% de son offre monétaire. Or, 42,9% de presque rien équivaut toujours à pas grand-chose, soit environ 60 000 $. Pour l’employeur, la surcharge liée à l’enseignement en ligne ne peut excéder 1000$ par an par personne chargée de cours, peu importe le nombre de cours qu’elle enseigne, et très peu de personnes pourraient accéder à ce maigre montant. Il faut savoir que la compensation de 750$ versée lors du premier enseignement d’un cours tout à distance ou comodal (et de 150$ pour un cours hybride) ne serait octroyée qu’aux personnes n’ayant jamais enseigné sous ces modalités, ce qui exclut de facto la plupart des personnes chargées de cours actuellement en lien d’emploi, notamment en raison de l’enseignement en non-présentiel durant la pandémie. Ensuite, selon l’employeur, notre surcharge ne mériterait que 50 ou 100$ par cours, soit bien moins que l’équivalent d’une heure supplémentaire à notre taux horaire par charge de cours. Si la Direction refuse également de limiter la taille des groupes cours, la surcharge liée à l’encadrement s’additionne à celle de la préparation. • Une autre priorité des membres est que les cours en ligne ne viennent pas remplacer nos cours en présence, mais que le développement de l’offre en ligne s’effectue en complémentarité. Malgré les multiples déclarations publiques de la Direction à cet égard, le fait est qu’aujourd’hui 28% des cours données par les personnes chargées de cours sont en ligne. C’est pourquoi les membres ont besoin de plus que des énoncés de principe, ils ont besoin de garanties devant l’augmentation constante de l’offre de cours en ligne. • Nous avons fait des contre-propositions et nous nous sommes montrés ouverts à trouver un compromis qui pourrait satisfaire les deux parties sur cet enjeu, mais l’employeur refuse de considérer ou répondre à toute offre qui limite l’autonomie départementale. Nous reconnaissons l’existence de cette autonomie, mais considérant la sous-représentation institutionnelle des personnes chargées de cours, la négociation de balises intégrées dans une convention collective a historiquement toujours été le moyen pour que notre voix soit prise en compte dans les décisions des départements, comme c’est le cas par exemple pour les EQE ou la clause réserve. Ceci ne constitue donc aucunement une remise en question des valeurs de démocratie et de collégialité de l’institution. Le recteur doit donner des mandats au comité patronal afin de répondre aux attentes des membres et de redonner un élan à la négociation. Davantage d’informations ont été données lors du Conseil syndical, à la suite duquel les personnes déléguées s’affairent à préparer le déclenchement du 3 février. Le Syndicat continuera de tenir les membres informés du déroulement de la négociation par ces instances ainsi que par l’entremise de l’infolettre. Solidairement,
Le SPPEUQAM
|
|
|
| |
Inscription aux quarts de travail sur les lignes de piquetage, aux fonds de grève et tractage les 29 et 30 janvier
|
Le SPPEUQAM a tenu un conseil syndical élargi à tous les membres mercredi. Nous avons fait le point à la suite du courriel de la direction sur l'état des négociations pour rectifier les faits. Nous avons ensuite ouvert les listes d'inscription aux quarts de travail sur les lignes de piquetage en vue du déclenchement de la grève le lundi 3 février. Toutes les personnes chargées de cours sont invitées à y mettre leur nom. Il est obligatoire de faire 12 heures par semaine pour toucher le Fond local de grève et de lock-out (FLGL) du SPPEUQAM et 20 heures par semaine pour recevoir le Fond de défense professionnelle de la CSN. Vous devez aussi vous inscrire à ces deux fonds. D'ici là, vous êtes conviés à une activités de mobilisation et de préparation les 29 et 30 janvier à 12h30 à l'Agora du Judith Jasmin ET à l'entrée du PK, métro Place des Arts . Nous ferons de la distribution de tracts et de la création de pancartes.
|
|
|
| |
Foire aux questions sur la grève
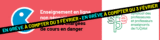
|
|
La résolution pour le déclenchement d’une grève au moment jugé opportun a été votée à 86 % lors de l’Assemblée générale du 2 décembre 2024. Le SPPEUQAM a annoncé par communiqué son déclenchement à compter du 3 février, jusqu’à l’obtention d’un règlement satisfaisant, à moins qu’une entente intervienne avec l’UQAM d’ici là. La partie patronale refuse de donner une réponse satisfaisante aux demandes de négociation adoptées par les membres en Assemblées générales en novembre 2023; le cahier de revendications en fait un résumé. Vous pouvez consulter les chroniques de négociation des infolettres. Vous pouvez aussi contacter le Comité de négociation. Voici une foire aux questions tentant de répondre à la plupart de vos interrogations face à la grève : • Qui est concerné • Quelle partie de votre travail • Qu’est-ce que vous devez faire ou ne pas faire d’ici le déclenchement • Qu’est-ce que vous pourrez et ne pourrez pas faire durant la grève • Qu’arrivera-t-il de vos accès à l’UQAM ou aux services institutionnels • Qu’en est-il des dispositions anti-briseurs de grève • Qu’arrivera-t-il avec l’affichage des cours d’été, avec les demandes d’EQE, avec le perfectionnement et les projets d’intégration et avec la reprise des cours s’il y a lieu. Nous vous proposons également un message type à programmer en réponse automatique à partir du 3 février. L’ESSENTIEL Qui est concerné par la grève ?
|
|
|
| |
La grève, comment ça se passe financièrement ?

|
|
Dès que la grève débute, des prestations de grève (non assujetties à l’impôt) peuvent vous être versées en fonction de votre participation aux lignes de piquetage. Le Fond local de grève et de lock-out (FLGL) du SPPEUQAM prévoit que toute personne inscrite sur au moins une liste de pointage départementale même si elle ne donne pas de charge de cours à l’hiver, personne chargée de cours donnant une charge de cours avec ou sans reconnaissance des EQE ou bénéficiant de la clause réserve (pour le trimestre en cours seulement) peut en bénéficier. Pour ce faire, cette personne doit être présente sur les lignes de piquetage au moins 4h par jour, pour un minimum de 3 jours. Durant la première semaine, elle recevra, pour chaque journée de participation, un montant de 200$, pour un maximum versé de 600$. Les semaines suivantes, ce montant sera de 100$ par jour pour un maximum de 300$ par semaine. Pour plus de détails. Le Fond de défense professionnelle de la CSN prévoit que toute personne qui subit une perte de salaire durant une semaine de grève déterminée, qu’il s’agisse de montants liés à une charge de cours, à la représentation sur un comité, à du perfectionnement ou à un projet d’intégration, peut en bénéficier pour cette semaine. La prestation est hebdomadaire et s’élève à 320$ par semaine pour 20h de piquetage. Pour plus de détails. Le temps de piquetage comprend également la participation aux comités de grève, aux éventuelles formations syndicales et assemblées d’information hebdomadaires. Les personnes chargées de cours ayant un autre emploi peuvent toucher des prestations des fonds de grève si l’autre emploi est antérieur au déclenchement de la grève. Par ailleurs, aucun remboursement n’est offert pour les frais de déplacement, de service de garde et de repas.
|
|
|
| |
Le personnel enseignant des cégeps et universités surmené par le travail confirme une enquête

|
|
Une étude scientifique partenariale inédite menée par le Service aux collectivités de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) confirme ce que les enseignant·es évoquent de plus en plus : la surcharge de travail s’est accrue de manière exponentielle avec et depuis la pandémie, provoquant une dégradation importante de leur santé mentale (détresse psychologique, solitude et anxiété), de leur santé générale et de la conciliation travail-vie personnelle. Quelque 500 personnes enseignant au niveau collégial et quelque 200 autres œuvrant au niveau universitaire ont rempli le questionnaire des chercheuses, qui ont également interrogé des groupes de discussion pour préciser qualitativement les données recueillies. Les indicateurs colligés dans les tableaux ci-bas sont sans équivoque quant à la surcharge de travail. Les courriels professionnels reçus lors du temps personnel auxquels employeurs, personnes étudiantes et collègues s’attendent à des réponses rapides sont monnaie courante. En outre, au total, près de 40 % des répondant·es affirment travailler bien plus que 45 heures par semaine (26,5 % travaillent entre 45 et 54 heures par semaine, alors que 12,6 % admettent y consacrer plus de 55 heures). D’ailleurs, la moitié (50,5 %) confient travailler « souvent » ou « toujours » durant les vacances.
|
|
|
| |
Requête au TAT : Un premier jalon vers un syndicat des stagiaires en enseignement
|
| |
Coupes dans les cégeps : un risque pour la formation continue

|
|
Les compressions budgétaires dans les cégeps au cours des derniers mois contraignent de nombreux établissements à annuler des programmes d’études destinés aux adultes alors que les organisations qui les embauchent sont plus que jamais motivées à investir dans la formation continue de leurs employées et employés en raison de l’effet sur l’amélioration des compétences du personnel. La Fédération du personnel professionnel des collèges (FPPC-CSQ) tire la sonnette d’alarme : les coupes entraîneront des conséquences sur le développement économique et social des régions. Les cégeps jouent un rôle central dans le perfectionnement de la main-d’œuvre québécoise, en particulier grâce à la formation continue et aux attestations d’études collégiales (AEC). Ces programmes, qui affichent un taux de placement en emploi de 88 %, sont essentiels pour répondre aux besoins des entreprises et des individus. Cependant, les coupes de financement, le plafonnement des heures travaillées et le gel d’embauches mettent à mal cette mission fondamentale, selon la FPPC-CSQ.
|
|
|
| |
Le personnel enseignant de Kativik reçoit l’appui de l’Internationale de l’Éducation
|
L’Internationale de l’Éducation (IE) soutient fermement les enseignantes et enseignants de la Commission scolaire Kativik dans leur négociation avec le gouvernement et « demande aux autorités publiques compétentes [du Québec] d’engager immédiatement des négociations de bonne foi ». L’IE, qui réunit quelque 375 organisations de travailleuses et travailleurs de l’éducation à travers le monde, dont la CSQ, a fait part publiquement de son appui au personnel enseignant en grève jusqu’au 21 janvier. L’organisation affirme que « le dialogue social constitue un droit fondamental des travailleuses et travailleurs ». Rappelons que les enseignantes et enseignants de la Commission scolaire Kativik, représentés par l’Association des employés du Nord québécois (AENQ-CSQ), ont exercé leur droit de grève, forts d’un mandat à hauteur de 88 %, afin d’exprimer leur exaspération au regard des négociations qui perdurent.
|
|
|
| |
13 000 travailleuses de CPE de la CSN en grève partout au Québec

|
|
Les près de 13 000 travailleuses des CPE affiliées à la CSN sont en grève partout au Québec pour exiger que le gouvernement en fasse plus afin de contrer la pénurie et de valoriser les emplois dans le secteur. Des rassemblements se tiennent dans l’ensemble des régions pour interpeller les députés et le gouvernement sur cette négociation majeure pour l’avenir des CPE. En négociation depuis plus de huit mois, la CSN, qui représente 80 % des CPE syndiqués, souhaite que cette journée de grève nationale force le gouvernement à accélérer la négociation. Dans les derniers jours, l’annonce de la tenue de cette première journée de grève touchant plus de 400 CPE n’a pas été suffisante pour que le gouvernement passe à la vitesse supérieure à la table de négociation. Tout cela alors que le réseau des CPE peine depuis des années à attirer et à retenir le personnel. Rappelons que les travailleuses des CPE affiliées à la CSN ont un mandat de cinq jours de grève adopté à 94 % et que d’autres journées de grève pourraient s’ajouter dans les prochaines semaines si la négociation n’accélère pas.
|
|
|
| |
La CSN dénonce vivement les fermetures sauvages d’Amazon au Québec

|
|
C’est par un simple courriel de l’un des avocats d’Amazon que la CSN et le syndicat représentant les 300 employé-es du centre DXT4 à Laval ont appris, tôt ce matin, la fermeture définitive de l’ensemble de ses entrepôts ainsi que sa volonté de céder la totalité de ses opérations au Québec à des sous-traitants. « Cette décision n’a aucun sens », s’offusque la présidente de la CSN, Caroline Senneville. « Ni sur le plan des affaires, ni sur le plan opérationnel. Amazon, l’une des compagnies les mieux intégrées entre le clic d’une souris et la livraison à domicile, confierait à une tierce partie l’ensemble de ses opérations d’entreposage et de distribution sur l’ensemble du territoire québécois ? Il y a des limites à nous prendre pour des valises. C’est tout le contraire du modèle développé par Amazon. » En fait, rappelle la présidente de la CSN, la seule spécificité du Québec réside dans la présence d’un syndicat officiellement accrédité, le seul au Canada. La CSN rappelle que les travaux devant mener à une première convention collective progressaient à l’entrepôt DXT4. Malgré les blocages d’Amazon, le syndicat était sur le point de déposer une demande d’arbitrage de convention collective, une disposition prévue au Code du travail du Québec. Autres textes sur le même sujet :
• Sondage sur l'expérience en ligne : Amazon incontournable, mais loin d’être favori.
• Une occasion pour la logistique au Québec.
• Pourriez-vous vous passer d’Amazon ?
|
|
|
| |
Grève générale illimitée chez Autobus La Montréalaise
|
| |
Élection partielle à Terrebonne : Le SCFP rappelle que Legault veut vous faire payer
|
| |
Quelques pages d’histoire syndicale et politique en janvier

|
|
Nous publierons une fois par mois un texte recensant quelques pages marquantes de l’histoire syndicale et politique. Ce texte est réalisé en collaboration avec l’Association internationale des machinistes et des travailleurs et des travailleuses de l’aérospatiale et le chargé de cours Michel-Philippe Robitaille. 1er janvier : Entrée en vigueur de la Sécurité de la vieillesse (1952) Le Parlement du Canada adopte la Loi sur la sécurité de la vieillesse en 1951. Il s’agit d’un régime de pensions financé et réglementé par le gouvernement fédéral. À l’époque, tout Canadien âgé de 70 ans et plus reçoit 40 $ par mois nonobstant sa situation financière. La Loi sur l’assistance-vieillesse est également adoptée à cette époque. Cette loi cible les Canadiens âgés de 65 à 69 ans. Les gouvernements fédéral et provinciaux se divisent les coûts et le régime est administré par les provinces. Le montant versé aux personnes admissibles est également de 40 $ par mois. Cependant, les bénéficiaires doivent faire la démonstration qu’ils en ont besoin et, par conséquent, ils s’exposent à des risques de stigmatisation. À la fois la Loi sur la sécurité de la vieillesse et la Loi sur l’assistance-vieillesse pavent la voie à l’actuel Régime de pensions du Canada et des prestations de sécurité de la vieillesse comme le Supplément de revenu garanti. Pour plus d’information, consultez cet article de L’Encyclopédie canadienne.
|
|
|
|
Monde social et de l'Éducation
|
|
| |
Plan stratégique de l’UQAM : L’écoresponsabilité en recul

|
|
Le 18 novembre dernier, le Plan stratégique 2024-2029 de l’UQAM a été dévoilé. À plusieurs égards, c’est un plan ambitieux. Il s’inscrit dans une volonté d’ouverture de l’UQAM aux enjeux hors des murs afin d’embrasser un rôle actif dans la société, sortant ainsi de la pure logique de compétition et de recherche de ressources. C’est dans cet esprit que nous saluons la création de la nouvelle Faculté des sciences de la santé et le projet de relance du Quartier latin; deux dossiers que nous suivrons avec enthousiasme et attention. C’est donc avec surprise que Le Montréal Campus a découvert que ce plan ambitieux mentionne si peu l’environnement. Pire : l’ambition timide du plan stratégique précédent a diminué. Il faut rappeler que l’UQAM a des expertises importantes en matière d’environnement et aurait le potentiel d’être figure de proue de la transition socioécologique. En 2019, l’UQAM s’est d’ailleurs jointe au mouvement mondial des universités en déclarant l’urgence climatique. Cependant, dans le Plan stratégique 2021-2024 qui a suivi, ce que l’Université reconnaissait dans la déclaration comme « la nécessité d’un changement social pour lutter contre la menace croissante des changements climatiques » s’est en fait traduite par l’intégration de la crise climatique comme un enjeu d’efficience organisationnelle.
|
|
|
| |
Cégeps et universités : L’IA bouscule la vie en classe

|
|
Des profs qui doivent revoir leurs méthodes d’évaluations. Des élèves qui se disent accusés à tort de tricherie. L’arrivée de l’intelligence artificielle générative chamboule le milieu des études supérieures, autant pour ceux qui enseignent que pour ceux qui apprennent. Un dossier de Léa Carrier dans La Presse. Dans les cégeps et les universités, l’avènement de l’intelligence artificielle est comparé à celui de l’internet ou de la calculatrice : il chamboule le milieu. Pour ne pas avoir à jouer à la police, des enseignants ont revu leurs méthodes d’évaluation : les étudiants font plus d’examens en classe et plus d’oraux. Même pour les productions écrites nécessitant plus d’une période de cours, Chantal Poirier ne permet pas aux élèves de repartir à la maison avec leur copie. Cette solution est loin d’être idéale, affirme-t-elle. Elle gruge du temps d’enseignement précieux : seulement pour cette session, elle estime avoir consacré le tiers de ses heures de cours à des évaluations. « C’est énorme », déplore-t-elle. Mais elle estime qu’elle n’a pas le choix. « Il y a toujours eu des étudiants qui trichent. Sauf que là, il y a une banalisation du plagiat », déplore Mme Poirier.
|
|
|
| |
Montréal : Le partage des installations sportives des écoles en danger ?
|
| |
Le délai d’attente en orthophonie s’étire pour les 5-6 ans
|
Le temps d’attente moyen pour la consultation d’un orthophoniste en CLSC s’allonge au Québec.Chez les enfants âgés de 5 à 6 ans, il a augmenté de deux mois entre janvier 2023 et janvier 2024, selon des chiffres obtenus par Le Devoir. Une situation qui préoccupe des professionnels de ce domaine, puisque les difficultés de langage peuvent compliquer le parcours scolaire. « On enseigne par l’oral, ce qui fait que la compréhension de l’enfant doit être au rendez-vous si on veut qu’il apprenne. C’est donc important qu’on détecte les problèmes de langage le plus tôt possible », affirme Paul-André Gallant, président de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec. « Les données scientifiques nous disent d’ailleurs que le délai raisonnable pour voir les enfants qui sont à risque devrait être d’un à trois mois », ajoute-t-il.
|
|
|
| |
François Legault nie que son gouvernement impose des compressions

|
|
Le premier ministre François Legault nie que son gouvernement veuille imposer des compressions dans le secteur de l’éducation, rapporte La Presse. M. Legault a annoncé la construction d’une nouvelle école secondaire, qui comptera 35 classes, six laboratoires, un auditorium, ainsi que deux gymnases et un terrain de football. Les travaux, qui représentent un investissement de 226 millions, débuteront en mai, pour se terminer à la fin août 2028, a-t-il dit. M. Legault a profité de l’annonce à Prévost pour rappeler tous les investissements que son gouvernement a faits en éducation. Le mois dernier, le gouvernement caquiste a cependant évoqué un contexte budgétaire difficile pour demander au réseau de l’éducation de faire un effort budgétaire de 200 millions d’ici au 31 mars. Cet effort ne devait pas viser directement les services aux élèves. Or, des centres de services scolaires (CSS) ont commencé à couper dans l’aide alimentaire, l’achat de livres et les sorties culturelles, a rapporté Le Journal de Québec, vendredi dernier. Interrogé à ce sujet lundi, M. Legault a d’abord déclaré qu’il y a actuellement « un grand débat » à savoir « s’il y a ou non des coupures ».
|
|
|
| |
Suspension d’élèves : Une mesure « inefficace » lourde de conséquences

|
|
Les écoles renvoient-elles trop souvent à la maison des élèves qui se comportent mal en classe ? Des protecteurs de l’élève s’inquiètent que des jeunes soient régulièrement empêchés d’aller à l’école… par leur école, qui les suspend. Il s’agit d’une mesure que l’on sait pourtant « inefficace », dit un professeur. Dans les rapports qu’ils ont produits après une année en poste, plusieurs protecteurs régionaux de l’élève se penchent sur les suspensions, souvent infligées à des élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, ou présentant des troubles du comportement. « Certains organismes scolaires se disent à bout de ressources. Il n’en demeure pas moins que tous les élèves, peu importe les évènements dans lesquels ils peuvent être impliqués, ont droit à la scolarisation », affirme Audrey Parizeau, protectrice de l’élève de la région des Grandes-Rivières, dans son rapport. Combien d’élèves par année sont renvoyés de leur école, et pour combien de temps ? Le ministère de l’Éducation ne conserve pas de données sur les suspensions, mais La Presse a obtenu des données du centre de services scolaire de Montréal. Après le non-respect du code de vie, qui est le principal motif de suspension, ce sont les actes de violence physique, puis verbale qui mènent à l’exclusion des élèves de l’école. Suivent l’intimidation, le vol ou le vandalisme, la possession illégale, la cyberintimidation et les violences sexuelles.
|
|
|
| |
Une étude associe les écrans et les tendances violentes des adolescents

|
|
L’exposition d’enfants d’âge préscolaire à des contenus violents à l’écran est associée à une augmentation des comportements antisociaux et violents chez les garçons à l’adolescence, prévient une nouvelle étude réalisée par une chercheuse de l’Université de Montréal. À l’âge de 15 ans, les garçons qui ont été exposés à ces contenus violents seront ainsi plus susceptibles de frapper ou de battre une autre personne dans l’intention de la voler ou d’en tirer avantage ; d’avoir recours à des menaces et des insultes ; de participer à des bagarres entre bandes d’adolescents ; et d’utiliser des armes. L’exposition a aussi été associée à une comparution devant la justice pour différents crimes, à des séjours dans des centres pour jeunes et à des interactions avec les forces de l’ordre. « Entre quatre et six ans, c’est la période pendant laquelle on apprend à interagir avec les autres, a dit l’auteure de l’étude, la professeure Linda Pagani, qui a discuté de ses travaux en primeur avec La Presse Canadienne. C’est à ce moment qu’on est socialisés. Et quand les enfants sont exposés à des modèles qui sont renforcés par rapport à la violence et l’agressivité, c’est ça qui arrive. »
|
|
|
| |
Des centaines d’artistes réclament une hausse du financement en culture

|
|
Des centaines d’artistes ont bravé le froid mercredi après-midi pour manifester devant les bureaux montréalais du premier ministre François Legault, rapporte Le Devoir. Ils réclament une hausse importante du budget du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ). Sur le coup de 15 h, c’est aux sons de la musique d’un DJ que les participants à la Grande Mobilisation des artistes du Québec (GMAQ) ont fait entendre leurs doléances. La frustration se lisait tant sur les visages que sur les pancartes (« Arts visuels invisibles », « Face au recul de la CAQ, nous créerons plus fort », ou encore « J’accepte les virements »). « On veut qu’on reconnaisse ce qu’on fait comme étant quelque chose de sérieux, d’essentiel », affirme avec détermination le danseur et chorégraphe Simon Renaud. À ses côtés, l’artiste en danse Marie-Philippe Santerre explique que le manque de financement des arts « se sent au quotidien », elle qui doit jongler avec plusieurs emplois « alimentaires » pour boucler ses fins de mois. « C’est important de se rassembler pour avoir l’impression d’appartenir à une communauté », pour éviter de « souffrir en silence », chacun de son côté, dit-elle.
|
|
|
| |
La génération qui ne parle pas au téléphone

|
|
Les moins de 30 ans sont quasiment nés avec un téléphone dans les mains, mais rendus à l’âge adulte, ils préfèrent laisser sonner plutôt que de répondre à un appel. Stress ou impolitesse ? Un dossier de Megan Foy dans La Presse. Leurs raisons sont variées. Un texto, par exemple, permet de répondre quand on a le temps, d’aller droit au but et de planifier son intervention. Un appel vidéo, de mieux saisir les intentions de l’autre grâce à ses expressions faciales. Mais, le téléphone… Tous ont immédiatement soulevé l’imprévisibilité de la chose. Un appel qu’on n’attend pas peut générer de l’anxiété, ou du moins, un petit stress, explique la Dre Emmanuelle Bastille-Denis, psychologue spécialisée en troubles anxieux et en troubles du sommeil. La Dre Bastille-Denis, qui fait des capsules éducatives sur sa chaîne TikTok, a par ailleurs publié une vidéo sur le sujet, qui a cumulé plus de 50 000 visionnements. Parmi les commentaires, quelques internautes confient que leur emploi ne serait pas le même s’il impliquait de s’entretenir au téléphone – ce qui n’a pas surpris la psychologue. « De façon générale, les gens qui vivent de l’anxiété peuvent essayer d’éviter leur peur », ajoute-t-elle. • Pourquoi fermer vos comptes internet est-il si difficile ?
|
|
|
| |
Devenir québécois

|
|
Saviez-vous qu’on trouve à Saint-Jean-de-Matha une rue des Cèdres-du-Liban? Ce toponyme rappelle la présence de longue date de la communauté syro-libanaise au Québec, qui remonte à la fin du XIXe siècle. Comme ce fait est largement méconnu, on ne soupçonne pas que des personnalités publiques comme René Angelil, ou des entreprises comme Dollarama, qu’on considère avant tout québécoises, ont en fait des origines dans cette région du Proche-Orient. Les étapes à franchir entre le moment où une personne s’installe dans un nouveau pays et celui où on « oublie » d’où viennent ses descendants sont nombreuses. Certains préjugés persistants à l’égard des immigrantes et des immigrants découlent d’une méconnaissance de ce processus d’intégration, comme en témoigne l’actualité récente. Le 23 décembre dernier, la journaliste de La Presse Suzanne Colpron faisait le portrait d’une famille originaire du Liban arrivée au Canada après un événement traumatique et de leur premier Noël au Québec. Le couple évoque les défis qu’ils doivent surmonter pour subvenir à leurs besoins : apprentissage de la langue pour le mari, retour à l’école en raison de la non-reconnaissance de leurs diplômes, intégration des enfants dans un nouveau système scolaire, etc. Pour lire la suite du texte de l'Institut de recherche et d'informations socioéconomiques.
|
|
|
| |
Itinérance : La Ville doit éviter de démanteler les campements, selon un rapport

|
|
La Ville de Montréal doit mieux encadrer ses interventions dans les campements de sans-abri et éviter de les démanteler tant qu’il manque de ressources d’aide et d’hébergement, selon le rapport d’un comité formé pour proposer des pistes de solutions à la crise de l’itinérance. Alors que des gens vivent dans des tentes à divers endroits, la Ville doit « mettre en place un protocole pour soutenir les personnes, évaluer la dangerosité de l’occupation d’un espace public, éviter les démantèlements et les encadrer lorsque nécessaire », indique le résumé du rapport, remis à l’administration le mois dernier, que La Presse a obtenu. Les discussions du comité, qui regroupait des représentants de plusieurs organismes communautaires, en plus d’employés de la Ville et d’experts du réseau de la santé et des services sociaux, ont permis de déterminer 15 pistes de solution pour agir plus efficacement auprès de la population itinérante. Mais l’approche face aux campements divise encore. Autres textes liés au logement et à l'itinérance (avec la collaboration du RAPSIM) :
• Montréal refuse un moratoire sur les démantèlements et propose un protocole.
• Une halte-chaleur supplémentaire à Montréal.
• Itinérance : Une navette qui réchauffe par temps glacial.
• Itinérance et grand froid : Montréal retient son souffle.
• Sans-abri avec une déficience intellectuelle : Réfugiés dans le métro depuis deux ans.
• Le ministre Carmant demande à Santé Québec « d’agir ».
• L’itinérance «déborde» à Longueuil.
• Prix des loyers : Le TAL suggère une hausse de 5,9 %.
• Hausse du prix des loyers: «La crise du logement est une préoccupation réelle».
• Hausse des loyers : Quand un gel vaut mieux que deux tu l’auras.
• Renouvellement de bail : Trucs et conseils pour les locataires et propriétaires.
• La ministre France-Élaine Duranceau propose peu de solutions... sauf de déménager.
• La CAQ dit en faire assez pour soutenir les locataires.
• Seul(e)s et sans domicile fixe.
|
|
|
| |
Transport interurbain : ce que le Québec peut apprendre du Pérou pour sortir de son marasme

|
|
Le réseau de transport interurbain par autocar au Québec est en crise, l’offre de transport ayant diminué de 85% dans les 40 dernières années. Cela met en évidence l’urgence de repenser le financement et les politiques publiques pour garantir une mobilité interurbaine accessible. Le Québec pourrait pour ce faire s’inspirer du Pérou, où le réseau interurbain est dense et efficace, reliant grandes villes et petites municipalités. Le système de transport en « combi » au Pérou offre un exemple de réseau de transport public urbain et interurbain qui se distingue par sa rapidité, sa flexibilité et son coût abordable. Les combis, généralement des fourgonnettes ou minibus pouvant transporter entre 10 et 20 passagers, suivent des itinéraires fixes, clairement indiqués sur des panneaux ou directement peints sur les véhicules. Grâce à leur petite taille, leur faible coût opérationnel et leurs itinéraires bien définis, les combis relient efficacement les quartiers, les grandes artères et les principaux centres urbains. Elles se démarquent aussi par leur capacité à atteindre des zones souvent négligées par les autobus publics ou les trains. Un article de l'Institut de recherche et d'informations socioéconomiques.
|
|
|
| |
Privatisation ou comment échouer sa transition énergétique en 4 étapes faciles : 2e partie

|
|
Dans un précédent billet, nous avons expliqué pourquoi le pouvoir privé sur l’investissement dans les énergies renouvelables limite leur développement. Dans ce billet, l'Institut de recherche et d'informations socioéconomiques analyse comment ces enseignements peuvent nous servir à comprendre la situation au Québec et le projet de loi 69 sur l’énergie. L’exception du Québec : combien de temps encore ? La situation de l’électricité au Québec est bien différente de celle des marchés de l’électricité ailleurs dans le monde à deux égards : non seulement notre électricité est déjà décarbonée, mais elle est en plus contrôlée principalement par un monopole public et n’est pas vendue aux consommateurs finaux en fonction de mécanismes du marché. En effet, au Québec, comme dans certains États des États-Unis, le prix de l’électricité est fermement régulé par des commissions publiques (ici, la Régie de l’énergie), sur la base du coût d’opération. Cet encadrement, qui s’est imposé dans nombre d’États dès le milieu du XXe siècle, repose sur une conception de l’électricité comme un service public indispensable à la satisfaction des besoins sociaux plutôt que comme une marchandise.
|
|
|
| |
Trump fera souffler un «vent glacial» sur les politiques environnementales du Canada
|
| |
Les fondations privées de charité : les contribuables en sortent-ils gagnants ?

|
|
Le Québec, avec ses 950 fondations privées, bénéficie de l’un des régimes fiscaux les plus généreux au monde. Les 15 fondations les plus riches redistribuent en moyenne 5 % de leur capital ou 43 % de leurs revenus, et voilà, elles sont « charitables » aux fins fiscales et ne paient pas d’impôt pour l’éternité. Alors qu’un vent d’austérité souffle sur la province, une question se pose : les Québécois bénéficient-ils du pacte fiscal conclu avec les fondateurs et leurs fondations ? Le fondateur d’une fondation privée peut bénéficier d’un crédit d’impôt pouvant atteindre 53 % sur ses dons. De plus, si ces dons sont réalisés sous la forme de certains biens spécifiques, comme des actions cotées en Bourse, il peut également profiter d’une exonération totale de l’impôt sur le gain en capital. Quant à la fondation, elle échappe à toute forme d’imposition, y compris sur les revenus générés par ses investissements. Cette exonération contraste avec celle d’autres pays, tels que les États-Unis, où les fondations sont soumises à une imposition sur leurs revenus de placement. Un texte de la fiscaliste et professeure Brigitte Alepin dans La Presse.
|
|
|
| |
Les Artistes Têtes Chercheuses présentent l’expo Les règles complices à Jonquière

|
|
Avec Les règles complices, le collectif Artistes Têtes Chercheuses (ATC), composé des chargées et chargé de cours Patricia Gauvin, Marie-France Giraudon, Jean Marois, Josée Pellerin et des retraitées Lise Nantel, Katherine Rochon, Anne C Thibault et Dominique Sarrazin, explore la notion de protocole comme rampe de lancement. Le vernissage de l’exposition aura lieu le dimanche 2 février à 14h au Centre national d’exposition de Jonquière, 4160, du Vieux-Pont, et l’exposition se poursuivra jusqu’au 24 avril du mardi au dimanche. Les choix effectués lors du processus de création et d'idéation influencent le résultat final de l'œuvre créée. Ainsi, les règles déterminant le protocole impactent l'esthétique finale d'une création, et la contrainte devient en quelque sorte le socle du cheminement dans l'élaboration du projet. Cette exposition collective traite de la relation entre la liberté de création et l'assujettissement aux règles. Car au-delà de la perception de béatitude et de spontanéité qu'amène la création chez le public, l'artiste a tout de même besoin de certains matériaux, de moyens financiers et d'un espace-temps particulier pour laisser libre cours à son imagination.
|
|
|
| |
Denise Proulx contribue au premier programme en environnements nourriciers
|
| |
Procès Gilbert Rozon : Les mythes et préjugés sous la loupe de Sandrine Ricci
|
La chargée de cours et sociologue Sandrine Ricci, qui a coécrit le rapport d’expertise sur les violences sexuelles — avec la professeure Karine Baril — a témoignée devant la cour, mardi, prenant le relais de sa collègue, rapporte La Presse. Elle a parlé des mythes qui tendent à normaliser ces violences, mais aussi de la mécanique des rapports de pouvoir. Plusieurs mythes sur le viol minimisent l’importance des violences sexuelles, a commencé par dire Sandrine Ricci, qui enseigne au département de sociologie. « Quand on dit que les femmes exagèrent, par exemple, ou quand on dit : ce n’est pas de la violence, c’est de la drague, tout cela minimise la portée des violences sexuelles. » • Le Devoir : Les mouvements de dénonciation et la culture du viol explorés au procès de Gilbert Rozon.
|
|
|
| |
La classe de Philippe Hamelin crée de nouvelles vidéoprojections dans le Quartier latin
|
| |
Godefroy Desrosiers-Lauzon parle des 55 ans du système métrique au pays
|
Il y a 55 ans, le Canada a abandonné le système impérial, qui utilise les pieds, pouces, onces, degrés Fahrenheit et autres, pour adopter le système métrique, qui utilise les mètres, centimètres, grammes et degrés Celsius. La communicatrice scientifique Viviane Lalande explique que la décision du Canada d’adopter le système métrique en 1970 s'inscrivait dans un mouvement international. Viviane Lalande et l’historien et chargé de cours Godefroy Desrosiers-Lauzon parlent également de ces unités que sont entre autres le kilogramme ou le mètre qui continuent d’évoluer au fil du temps à l'émission Pénélope, à l'antenne de Radio-Canada. À tel point que des scientifiques se réunissent tous les quatre ou cinq ans pour faire le point à leur sujet.
|
|
|
| |
Jean Régnier a passé proche de mourir dans Stat
|
Notre ex-collègue et ex-vice-président à l'information, maintenant à la retraite, Jean Régnier, a repris son ancien emploi d'acteur. On pouvait le voir cette semaine dans la quotidienne Stat, à l'antenne de Radio-Canada. Reposant sur une civière à l'urgence, une fausse docteure lui injecte un produit contre-indiqué dans sa condition physique ce qui entraine un arrêt cardiaque. Il est réhanimé par les vrais médecins.
|
|
|
| |
Congédiement de l’ex-greffière de Saguenay : une facture salée selon Gilles Dulude
|
| |
La politique étrangère du Canada : une rhétorique ambitieuse, mais des résultats modestes selon Nicolas-Francois Perron
|
| |
Bannissement de TikTok aux États-Unis : Laurence Grondin Robillard commente
|
La chargée de cours de l'École des médias Laurence Grondin Robillard a commenté le bannissement de TikTok aux États-Unis et sa validation par la Cour suprême américaine, le tout dans le cadre des émissions Ça nous regarde et Le 15-18, à l'antenne de Radio-Canada.
|
|
|
| |
Julien Tourreille explique ce qu’il faut savoir sur la journée d’assermentation de Donald Trump
|
C’est lundi que Donald Trump s’est installé officiellement dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Comment s'e'est déroulé cette journée? Certaines décisions annoncées, notamment des tarifs douaniers, pourraient-elles être mises en application dès maintenant? Voici ce qu’il faut savoir. « En janvier 2017, il avait dépeint un pays dans une situation catastrophique, en ruine, où tout allait très, très mal, donc je suis curieux de voir s'il va reprendre cette même thématique », indique Julien Tourreille, chargé de cours et chercheur en résidence à l'Observatoire sur les États-Unis de la Chaire Raoul-Dandurand, à Radio-Canada. Autres interventions médiatiques de Julien Toureille :
• Bilan des années Biden avec Martine St-Victor et Julien Tourreille.
• Donald Trump a «une mainmise sur son parti, mais il y a de dissensions internes».
|
|
|
| |
Rafael Jacob sur la route des différences canado-américaines
|
| |
Christophe Cloutier-Roy répond à la question : l’assermentation de Donald Trump est-elle obligatoire?
|
Le président désigné, Donald Trump, et le vice-président désigné, J.D. Vance, ont été assermentés le lundi 20 janvier. La cérémonie d’intronisation comprend plusieurs éléments, mais un seul est requis par la Constitution des États-Unis : la prestation de serment. C’est le vice-président qui prêtera serment en premier, puis, sur le coup de midi, ce sera au tour du président. « C’est toujours à midi, parce que le terme présidentiel se termine à midi le 20 janvier suivant une élection présidentielle », explique le chargé de cours et directeur adjoint de l’Observatoire sur les États-Unis de la Chaire Raoul-Dandurand, Christophe Cloutier-Roy au Devoir.
|
|
|
| |
Madeleine Goubau et Philippe Denis commentent la mode lors de l’investiture américaine
|
Les chargé.es de cours Madeleine Goubau et Philippe Denis commentent la mode lors de l’investiture américaine à l'émission Le 15-18 à l'antenne de Radio-Canada. Madeleine Goubau commente également la casquette politique, une communication efficace à l'émission Fin PM, aussi à Radio-Canada.
|
|
|
| |
Bruno Boulianne commente le documentaire Okurimono de Laurence Lévesque
|
En cette période faste pour le documentaire québécois, le chargé de cours et cinéaste Bruno Boulianne a commenté la sortie du premier long métrage de la cinéaste Laurence Lévesque, Okurimono, documentaire qui se déroule au Japon. Il était interviewé à l'émission Il restera toujours la culture, à l'antenne de Radio-Canada.
|
|
|
| |
Astroturfing : Justine Lalande explique cette technique de manipulation évoquée dans l’affaire Blake Lively

|
|
En français, on appelle ça du « similitantisme », mais le mot anglais est bien plus répandu : l’astroturfing, rapporte le magazine Elle. Récemment, il a été cité dans l’affaire Blake Lively. L’actrice se trouve en plein bras de fer juridique contre Justin Baldoni, le réalisateur du film « Jamais Plus » dont elle était à l’affiche l’été dernier, et Wayfarer, le studio qui a produit le long-métrage à succès. Fin décembre, elle a porté plainte pour harcèlement sexuel sur le tournage. Dans le texte de la plainte, qu’ont pu consulter différents médias américains le 20 décembre dernier, elle accuse aussi le metteur en scène d’avoir organisé une campagne de diffamation à son encontre sur les réseaux sociaux. Depuis, un mot pour définir cette technique de propagande s’est imposé partout : l’astroturfing. Selon Justine Lalande, chargée de cours et doctorante à l’UQAM qui a récemment défini le concept pour le site « The Conversation », l’astroturfing est « la fabrication de toute pièce de faux mouvements citoyens pour donner l’illusion qu’une majorité appuie un certain point de vue ».
|
|
|
|









































