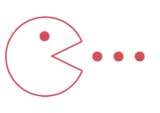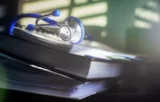| |
Entre vous et moi
Le recteur Pallage nous a écrit jeudi : « Cette fin de semaine sera aussi notre chance de finaliser la négociation avec le SPPEUQAM sur l’enseignement en ligne. Je serai disponible jour et nuit si nécessaire pour arriver à l’entente à laquelle, je l’espère, chaque partie aspire. » Ça adonne bien parce que notre comité de négociation et notre président seront aussi disponibles jour et nuit et arriveront samedi avec une offre globale. La balle sera donc dans le camp de l'employeur, à lui de décider s'il veut une grève ou non. Petite question comme ça : est-ce qu'ils ont plusieurs lits au ministère du Travail ? On couchera tout de même pas dans le même lit. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous donne rendez-vous lundi matin au local de grève, 1254 rue Saint-Denis, pour piqueter… ou festoyer. Dans les deux cas, le rendez-vous est à 8h30. Bonne lecture, Richard Bousquet
Vice-président à l'info du SPPEUQAM
|
| |
| |
Le point sur la négo et la grève du SPPEUQAM

|
|
La grève est toujours à l’ordre du jour à compter de lundi, le 3 février, et les membres du syndicat doivent agir en conséquence en se présentant au local de grève, 1254 rue Saint-Denis, au début des quarts de travail choisis pour qu'on leur assigne un endroit de piquetage. Mais dans un souci de donner une dernière chance à la direction de l’UQAM dans la négociation de nos conditions encadrant l’enseignement en ligne, votre comité de négociation a pris le temps d’explorer toutes les avenues de solutions possibles et a élaboré une offre globale qu’il compte présenter le samedi 1er février à la partie patronale, toujours dans le cadre de la conciliation. Cette offre met de l’avant des pistes de règlements sur chacune des demandes des membres, incluant plusieurs compromis réalistes permettant de satisfaire au moins en partie les préoccupations des personnes chargées de cours tout en étant selon nous acceptables pour la partie patronale. Les deux parties négocieront probablement toute la fin de semaine, mais l’atteinte d’un règlement n’est pas assurée. La directive du syndicat demeure donc, qu’en prévision du déclenchement de la grève, les personnes chargées de cours doivent choisir leurs plages horaires sur les listes d’inscription aux quarts de travail sur les lignes de piquetage et s’inscrire aux deux fonds de grève. Nous vous invitons aussi à lire la foire aux questions sur la grève, les conditions financières de notre arrêt de travail et les chroniques de négociation. Si les deux parties devaient s’entendre en fin de semaine, les membres seraient avisés par courriel le plus rapidement possible. En 2022, le règlement était survenu à 5 heures du matin de la grève. Mais en attendant nous vous donnons rendez-vous au local der grève, 1254 rue Saint-Denis, et ensuite sur les lignes de piquetage lundi matin. Solidairement,
Le SPPEUQAM
|
|
|
| |
Tous convergent vers le local de grève
|
Les membres du SPPEUQAM sont prêtes et prêts pour la grève! Le syndicat s’est déjà procuré un local à cet effet: situé au 1254 rue Saint-Denis (directement en face du bureau du syndicat). Rendez-vous lundi matin 3 février dès 8:30 à notre local de grève, ou au début de votre quart de travail selon les disponibilités que vous avez indiquées dans le formulaire (https://forms.office.com/r/ATJ4r99DpQ). Les grévistes se diviseront par la suite en sous-groupes vers différentes portes de l’UQAM stratégiquement présélectionnées par le syndicat pour y effectuer du piquetage et maximiser notre visibilité. On veut se faire entendre! Solidairement,
Votre comité mobilisation-intégration
|
|
|
| |
Chronique de la négo : De retour à la table pour obtenir un règlement satisfaisant pour les membres
|
À quelques jours du déclenchement d’une grève, amener la partie patronale à négocier dans l’intérêt des membres est la priorité numéro 1. Votre comité de négo a travaillé sans relâche au cours des derniers jours afin de forcer un retour à la table de négociation. Voici les grandes lignes de ce qui s’en vient. Tel que rapporté dans notre communiqué, lors de la séance de négociation du 21 janvier dernier, le conciliateur avait dû constater l’impasse : les deux parties avaient réagi aux propositions soumises par l’autre et aucune nouvelle proposition n’était sur la table. Il avait alors pris la décision de mettre en pause la négociation en attendant que de nouvelles offres de compromis soient présentées par l’une ou l’autre des parties. Votre comité de négociation a pris le temps d’explorer toutes les avenues de solutions possibles et a élaboré une offre globale qu’il compte présenter samedi le 1er février à la partie patronale, toujours dans le cadre de la conciliation.
|
|
|
| |
Une forte solidarité étudiante
Depuis l’annonce de l’exercice de notre mandat de grève pour le 3 février, nous avons reçu des appuis de la plupart des syndicats et associations étudiantes de l’UQAM. Plusieurs assemblées générales d’associations étudiantes facultaires ont déjà voté à l’unanimité des mandats de grève solidaire. Et c’est normal puisque, au-delà de la solidarité légendaire de la communauté uqamienne, « nos conditions d’enseignement sont les conditions d’étude des étudiant-es ». L’AFESH (Sciences humaines) a parti le bal la semaine dernière, en votant à l’unanimité un mandat de « grève générale illimitée de tous les cours en solidarité avec le SPPEUQAM jusqu’à ce que celui-ci y mette fin ». Ensuite, cette semaine, l’AFESPED (Science politique et Droit) et l’AFEA (Arts) ont voté à l’unanimité pour des mandats de grève solidaire. Ce soir (30 janvier) nous sommes invité-es à l’AG de l’ADEESE (Science de l’éducation), pour un vote de grève solidaire. L’AFELC (Langues et Communication) exercera son mandat de grève solidaire automatique de 3 jours et tiendra une AG pour reconduire son mandat à la fin de ce délai. L’AESS (Secteur des Sciences) convoque, quant à elle, une AG de grève solidaire le 5 février.
|
| |
| |
Foire aux questions sur la grève
|
Voici une foire aux questions tentant de répondre à la plupart de vos interrogations face à la grève : • Qui est concerné • Quelle partie de votre travail • Qu’est-ce que vous devez faire ou ne pas faire d’ici le déclenchement • Qu’est-ce que vous pourrez et ne pourrez pas faire durant la grève • Qu’arrivera-t-il de vos accès à l’UQAM ou aux services institutionnels • Qu’en est-il des dispositions anti-briseurs de grève • Qu’arrivera-t-il avec l’affichage des cours d’été, avec les demandes d’EQE, avec le perfectionnement et les projets d’intégration et avec la reprise des cours s’il y a lieu. Nous vous proposons également un message type à programmer en réponse automatique à partir du 3 février. L’ESSENTIEL Qui est concerné par la grève ? Toutes les personnes chargées de cours couvertes par notre certificat d’accréditation.
|
|
|
| |
La grève, comment ça se passe financièrement ?
|
| |
Vœux et résolutions pour réenchanter l’enseignement

|
|
Le tournant de l’année, entre le tourbillon de festivités et le répit d’entre deux sessions vient, pour plusieurs, avec son lot d’enthousiasme. En cette période de bons vœux, le comité école et société souhaite chaleureusement à l’ensemble des membres de la FNEEQ une année riche en rencontres, en échanges intellectuels, en débats féconds et en découvertes. Le comité école et société (CES) de la FNEEQ propose de collectivement prendre la résolution salvatrice : (ré)enchanter l’enseignement ! Parce que oui, l’enseignement est un métier formidable, tellement humain, porteur d’un projet social, producteur de sens et créateur de commun, mais il est aussi traversé de tâches administratives, de production de documents institutionnels plus ou moins stimulants, de correction ennuyante et répétitive, de réunions pas toujours motivantes qui plombent un horaire déjà surchargé. S’il nous arrive de reprocher à nos étudiant∙es de succomber aux sirènes de l’intelligence artificielle (IA) lorsqu’iels réalisent des travaux scolaires, il faut admettre que, de notre côté aussi, la tentation peut être forte d’y recourir pour nous acquitter de ces tâches « pénibles » et chronophages : À l’IA le « plate », à nous le « fun » !
|
|
|
| |
Des initiatives innovantes pour contrer l’homophobie et la transphobie en milieu scolaire
|
| |
Surmenage chez les enseignants : La FNEEQ et le Cégep de Saint-Jérôme prennent action
|
| |
Journée internationale de l’éducation : mobilisons-nous pour l’avenir de l’éducation publique!

|
|
La pénurie de main-d’œuvre et le manque de valorisation ne touchent pas seulement le système scolaire québécois : l’enjeu est mondial! À l’occasion de la Journée internationale de l’éducation, le 24 janvier, l’Internationale de l’Éducation (IE), dont font partie la CSQ et la CSN, a organisé un webinaire dédié au lancement de son dernier rapport mondial sur la condition du personnel enseignant. Ce rapport, basé sur les données collectées auprès de 204 syndicats dans 121 pays, brosse un portrait saisissant des défis auxquels fait face la profession enseignante. La pénurie d’enseignantes et d’enseignants, aggravée par des conditions de travail précaires, des salaires insuffisants et un faible statut professionnel, est au cœur de ce rapport. Les conclusions sont claires : il est impératif d’investir massivement dans l’éducation publique et de revaloriser le métier d’enseignant. Ces enjeux concernent particulièrement les domaines de la science, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques (STIM), l’éducation spécialisée et l’enseignement secondaire, où les besoins sont criants.
|
|
|
| |
Front commun pour les arts : « Il y a péril en la demeure », dit l’UDA

|
|
Une semaine après la manifestation de la Grande mobilisation pour les arts au Québec, c’était au tour du Front commun pour les arts de convier les médias, mercredi, dans les locaux de HEC, pour réclamer une hausse du financement du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ). « Il est urgent de constater qu’il y a péril en la demeure. Les artistes ont toujours été résilients, mais là on a un genou à terre », a soutenu la présidente de l’Union des artistes (UDA), Tania Kontoyanni à La Presse. Le Front commun pour les arts, qui réunit maintenant 21 organismes culturels et qui représente plus de 50 000 artistes, demande au premier ministre Legault de faire passer le budget du CALQ à 200 millions par année et d’indexer cette somme au coût de la vie. Il est présentement à 170 millions. L’augmentation des coûts de production de 30 % à 50 %, la transformation numérique, le changement des habitudes de consommation du public, la non-indexation des subventions du CALQ, sont quelques-unes des causes à l’origine des difficultés financières vécues par les organismes culturels et les artistes, a commencé par dire Caroline Gignac, directrice générale du Conseil québécois du théâtre (CQT).
|
|
|
| |
Une deuxième journée de grève le 6 février pour les 13 000 travailleuses de CPE de la CSN
|
| |
Six mois de lock-out au Zoo de Granby!

|
|
Les négociations du Zoo de Granby avec ses syndiqué-es s’étirent depuis février dernier. Malgré 63 séances de négociation, dont 54 avec la conciliation du ministère du Travail, les offres patronales sont toujours insuffisantes. La direction du zoo maintient son lock-out depuis le 29 juillet dernier. « Les dernières offres salariales ne permettent pas d’améliorer notre pouvoir d’achat par rapport à la dernière convention collective. Après six mois sans salaire en raison d’un lock-out patronal, on demande au zoo de faire mieux », soutient Camille De Rome, porte-parole du Syndicat national des salarié-es de la Société Zoologique de Granby–CSN, qui comptait quelque 130 membres au début du conflit de travail. Le directeur du zoo affirme aujourd’hui qu’il n’a pas les moyens de faire plus. Le syndicat fait toutefois remarquer que d’avoir volontairement déclenché et maintenu un lock-out engendre de nombreux frais et des manques à gagner pour l’organisation sans but lucratif. On pense ici à des primes pouvant atteindre 700 $ par semaine pour les cadres qui remplacent les syndiqué-es, des frais juridiques importants, une firme nationale de communication, des gardiens de sécurité pour surveiller la ligne de piquetage, la fin des visites de naturalistes dans les écoles et la fin de l’activité le Zoo la nuit. Tout cet argent aurait bien entendu été utile pour répondre aux demandes légitimes des syndiqué-es. Autres syndicats CSN en conflit :
• Syndicat des travailleurs de Demix Lasalle-Longueuil : Lock-out depuis le 5 décembre 2024
• STT de l’Hôtel Reine Elizabeth : Lock-out depuis le 20 novembre 2024
• Syndicat des travailleuses et travailleurs en intervention communautaire : Section Centre l’Entre-Toit : en grève depuis le 1er novembre 2024
• Syndicat des travailleuses et travailleurs de l’Hôtel Côte-de-Liesse : en grève depuis le 1er novembre 2024
|
|
|
| |
Une levée de boucliers contre le développement éolien antidémocratique
|
| |
PL 88 : Le résultat d'un long processus de contestation mené par les organisations syndicales
|
| |
Balado de la CSQ : Les enjeux du monde du travail en 2025
|
| |
Les quatre centrales syndicales demandent à Jean Boulet de renforcer les lois du travail

|
|
Les quatre centrales syndicales du Québec ont rencontré le ministre du Travail, Jean Boulet, vendredi, pour lui demander de « rééquilibrer le rapport de forces » entre employeurs et travailleurs, et de renforcer des lois du travail qu’elles jugent désuètes, rapporte La Presse canadienne. La CSD, la CSN, la FTQ et la CSQ rencontrent régulièrement le ministre du Travail pour traiter avec lui de différents sujets. Cette fois, la rencontre en visioconférence a eu lieu alors que le géant Amazon vient d’annoncer la fermeture de ses entrepôts au Québec. Or, un des entrepôts d’Amazon avait obtenu son accréditation syndicale l’an dernier et l’affaire s’était retrouvée devant les tribunaux. Au fédéral, en invoquant le Code canadien du travail, le ministre Steven MacKinnon est intervenu dans des conflits de travail dans le rail, dans des ports et à la poste. Et juste avant Noël, lors d’une entrevue, le ministre Boulet a dit réfléchir à une façon de modifier le Code du travail du Québec pour faciliter à son tour une forme de règlement des conflits qui perdurent ou sont enlisés.
|
|
|
|
Monde social et de l'Éducation
|
|
| |
Affaires universitaires soulignent la grève imminente des chargés de cours de l’UQAM
|
| |
Les chargés de cours de l'UQAM en grève lundi, à moins d’une entente d’ici là

|
|
Les 2100 chargés de cours de l’UQAM annoncent une grève à compter de lundi, à moins qu’un règlement intervienne d’ici là pour renouveler leur entente collective, rapporte La Presse canadienne. Des négociations de la dernière chance doivent avoir lieu en fin de semaine pour tenter d’éviter le déclenchement de la grève, qui serait d’une durée illimitée, a précisé en entrevue jeudi Olivier Aubry, président du Syndicat des professeures et professeurs enseignants de l’Université du Québec à Montréal. Fait particulier, il ne s’agit pas de renégocier toute la convention collective, mais seulement les aspects qui ont trait à l’enseignement en ligne. L’entente collective dans son ensemble avait déjà été renouvelée ; elle est encore en vigueur jusqu’au 31 décembre prochain. Il était prévu de la rouvrir pour négocier les conditions de travail en lien avec l’enseignement en ligne, a expliqué M. Aubry. Le syndicat, rattaché à la Fédération nationale des enseignant(e)s du Québec, affiliée à la CSN, représente des chargés de cours et des superviseurs de stages.
|
|
|
| |
« Une présidence Trump affaiblira les universités », selon Pallage
|
| |
Un étudiant handicapé poursuit l’UQAM pour atteinte à ses droits fondamentaux

|
|
Un étudiant en fauteuil roulant réclame près de 100 000 $ à l’UQAM parce qu’il peine à utiliser des toilettes « adaptées », à tel point qu’il est tombé à plusieurs reprises. Une situation qu’il tente de faire corriger depuis plusieurs années et qui lui a apporté « honte et frustration ». Olivier (prénom fictif) a terminé un baccalauréat en informatique à l’UQAM et veut bientôt entreprendre une maîtrise. Il se déplace en fauteuil roulant depuis qu’une rupture d’anévrisme survenue à l’âge de 14 ans l’a laissé en partie paralysé. Aujourd’hui dans la trentaine, il se bute, depuis le début de ses études universitaires, à de nombreux obstacles pour un besoin des plus élémentaires : aller aux toilettes. « Je suis tombé plusieurs fois et j’ai même uriné sur moi parce que la seule toilette accessible était au quatrième étage »,dit Olivier. Bien que la procédure judiciaire soit publique, La Presse a accepté de ne pas nommer l’étudiant pour préserver sa dignité. Certaines toilettes censées être accessibles aux personnes en fauteuil roulant ne le sont pas, déplore la poursuite déposée en décembre au palais de justice de Montréal.
|
|
|
| |
Études supérieures : Même les boursiers en arrachent financièrement

|
|
Ils sont considérés comme la crème de la relève scientifique… et vivent sous le seuil de la pauvreté. Appuyés par des chercheurs et des professeurs, des étudiants boursiers aux cycles supérieurs réclament un meilleur soutien financier de Québec. Des centaines d’étudiants boursiers « peinent à joindre les deux bouts », signale un regroupement d’associations étudiantes, de professeurs et de chercheurs. Dans une lettre adressée à Québec obtenue par La Presse, ils réclament un rehaussement du montant des bourses d’excellence du Fonds de recherche du Québec (FRQ), remises chaque année à la crème des étudiants. À la maîtrise, elles totalisent 20 000 $ par année. Au doctorat, 25 000 $ par année. Résultat : ils sont condamnés à vivre près du seuil de la pauvreté, voire au-dessous. « En ce moment, les étudiants qui reçoivent la bourse ne peuvent pas subvenir à leurs besoins », résume Étienne Paré, président de l’Union étudiante du Québec, qui a eu l’initiative de la lettre. Le programme de bourses provincial ne sert pas seulement à financer les études supérieures : il sert aussi de salaire. « Quand t’es rendu à la maîtrise et au doctorat, c’est un travail à temps plein, et même souvent un peu plus », illustre Étienne Paré.
|
|
|
| |
Des étudiants infirmiers victimes de racisme en Abitibi

|
|
Insultes les traitant « d’incompétents », propos racistes et humiliations répétées. Des infirmiers et infirmières recrutés en Afrique ont été victimes d’intimidation et de dénigrement au cégep de l’Abitibi-Témiscamingue et dans les hôpitaux de la région où ils ont été formés, selon un rapport obtenu par Le Devoir auprès de l’organisme chargé de fournir du soutien pédagogique. Une situation qui a mené à une vague d’échecs au printemps 2024. Les exemples de remarques racistes et humiliantes se succèdent dans le rapport lourdement caviardé dans lequel témoignent une dizaine de ces futurs soignants formés à Amos et La Sarre. « Les étudiants d’Amos rapportent que, dans une mise en situation, l’enseignante aurait commencé en disant : “Il paraît qu’en Afrique, vous êtes tous des animaux. C’est pour ça qu’au Rwanda, les gens se sont entretués” », lit-on dans le document obtenu en vertu de la loi sur l’accès à l’information. « D’autres ont parlé d’insultes de la part de l’enseignante (“vous êtes nuls, des incompétents, vous ne savez rien”), qui ont suscité l’humiliation. » Autres textes sur le même sujet :
• Une infirmière congédiée après avoir soutenu des étudiants africains en Abitibi.
• Le racisme à l’endroit d’infirmiers africains dénoncé au Parlement.
• Des étudiants africains abandonnés sans possibilité de reprise.
|
|
|
| |
Québec met sur pause du soutien aux élèves immigrants et autochtones
|
| |
Îlot Voyageur : Une entente enfin signée pour construire 1000 logements

|
|
Deux acteurs de l’immobilier se sont finalement entendus avec Montréal pour construire plus de 1000 logements dans la partie sud de l’Îlot Voyageur, a appris La Presse. Mais le chantier ne commencera pas avant l’été, comme le souhaitait la mairesse. En entrevue avec La Presse, le responsable de l’urbanisme au comité exécutif, Robert Beaudry, parle d’un développement « majeur ». « Ça veut dire que les investissements, les études, les accès au site, le travail sur la réglementation, tout ça va commencer et va se faire de façon vraiment plus poussée », affirme-t-il. Des 1030 logements prévus, 500 seront développés et gérés par Mondev, un promoteur privé déjà très actif dans l’est du centre-ville. Les 530 autres unités, développées par l’organisme Unité de travail pour l’implantation de logement étudiant (UTILE) , seront à but non lucratif : 430 seront destinées à des étudiants, et 100 seront aménagées dans la Maison des gens de lettres, qu’on décrit comme un espace de vie et de travail abordable pour écrivains et professionnels du domaine littéraire, et pour des familles à faible ou modeste revenu.
|
|
|
| |
Relations : La mise à mort d’une grande revue

|
|
La quasi-doyenne des revues du Québec est récemment disparue sans faire trop de bruit. Ses artisans, par contre, acceptent mal ce qu’ils considèrent comme « un acte subtil de censure », dans un texte publié dans La Presse. La revue Relations est morte. Dès sa suspension en mars dernier, nous étions parmi les nombreuses personnes à penser que cela allait l’affaiblir au point où elle ne s’en remettrait jamais. Voilà, c’est fait. Cette fin est plus que triste, une mort sans dignité en quelque sorte, à 84 ans. Peu de revues mettent de l’avant un pareil équilibre entre l’art et les idées, entre une spiritualité engagée et le débat social, entre l’analyse des grands enjeux de notre temps et les sujets plus philosophiques et intemporels, jouant avec modestie un rôle rassembleur. C’est donc cette revue si particulière qu’ont fermée les jésuites, invoquant des « défis financiers et organisationnels » qui ne convainquent pas grand monde. Ils s’en défendent, mais la manière dont ils ont mis à l’écart les principaux concernés depuis des mois laisse penser que l’orientation de la revue dérangeait. Était-elle trop québécoise dans un écosystème jésuite devenu pancanadien ? On ne le saura jamais. Mais chose certaine, dans un monde où la droite radicale s’affirme de plus en plus, de façon décomplexée, il est désolant de voir disparaître un pôle de réflexion aussi libre et substantiel, clairement axé sur les avancées sociales et la rigueur intellectuelle. Il est difficile de ne pas considérer la décision d’en finir avec Relations comme un acte subtil de censure.
|
|
|
| |
Automobilistes délinquants : Hausse des blessures liées au transport scolaire
|
| |
Amazon ou les paradis fiscaux contre les travailleurs et les travailleuses

|
|
Quand on est une multinationale qui ne paie pas d’impôt, ou à peine, il est plus aisé de s’acquitter de quelconque amende ou dommages et intérêts, des années plus tard, pour avoir contrevenu au Code du travail. Quand on ne paie pas d’impôt, ou à peine, il est aussi plus facile d’accepter de fermer des entrepôts fraîchement construits et d’enregistrer des pertes sèches cumulant des millions de dollars afin de tuer dans l’œuf un mouvement de syndicalisation. En 2023, l’Institut de recherche et d'informations socioéconomiques (IRIS) publiait une étude faisant état de quelque 120 milliards de dollars de profit net transférés au Luxembourg par des entreprises canadiennes dans la dernière décennie. Cette étude s’étant concentrée sur des firmes canadiennes, leurs consœurs américaines et internationales n’avaient pas été recensées. Les frasques récentes d’Amazon au Québec sont l’occasion de s’y attarder, d’autant plus que le siège social européen de ce géant est basé, sans surprise, au Luxembourg. Autres textes sur Amazon :
• L’intrigante fermeture d’Amazon au Québec : Des motifs antisyndicaux.
• Sondage | Fermeture des entrepôts d’Amazon : une décision qui ne passe pas.
• Les fermetures d’Amazon au Québec sont une question de contrôle, pas de coûts.
• Ici, on boycotte Amazon.
• Amazon : Les unions, qu’ossa donne ?
|
|
|
| |
Pourquoi les scientifiques migrent-ils vers Bluesky ?

|
|
Les chercheurs du monde entier quittent massivement X pour Bluesky. Pour éviter le harcèlement et l’extrémisme, pour suivre leurs collègues ou par antipathie pour Elon Musk., rapporte La Presse. Les scientifiques québécois n’échappent pas à cette tendance. Plusieurs chercheurs au Québec, dont certains sont relativement connus, comme Martin Juneau, de l’Institut de cardiologie de Montréal, Rémi Rabasa-Lhoret, endocrinologue à l’Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM), et Sébastien Sauvé, spécialiste des contaminants à l’Université de Montréal. « Chez nous, les scientifiques sont en pleine migration », dit Florence Meney, directrice des communications à l’IRCM. Des sommités québécoises du diabète ont aussi quitté X, rapporte le Dr Rabasa-Lhoret. Certains chercheurs, dont Caroline Ménard, biologiste à l’Université Laval, n’ont pas techniquement fermé leur compte X, mais ne l’utilisent plus. « J’ai toujours mon compte Twitter puisque je ne veux pas que quelqu’un utilise mon identifiant, qui compte plusieurs milliers de followers », explique Mme Ménard. • Temps d'écran chez les jeunes : QS déplore l’hésitation de la CAQ à forcer Meta à témoigner.
• Coffres à butin : « Du gambling pour les jeunes ».
|
|
|
| |
Course à l’IA : Meta prévoit d’investir jusqu’à 65 milliards US en 2025

|
|
Meta (Facebook, Instagram), prévoit d’investir jusqu’à 65 milliards de dollars cette année, soit 50 % de plus qu’en 2024, principalement pour défendre et renforcer sa position dans la course à l’intelligence artificielle (IA), rapporte l'Agence France-Presse. « Cette année sera déterminante pour l’IA. En 2025, je m’attends à ce que Meta AI soit le principal assistant IA au service de plus d’un milliard de personnes, à ce que Llama 4 devienne le principal modèle de pointe et à ce que nous créions un ingénieur IA qui contribuera de plus en plus à nos efforts de recherche et de développement », a déclaré Mark Zuckerberg, le patron de Meta, sur son profil Facebook vendredi. Les « 60 à 65 milliards de dollars » serviront à étoffer « considérablement » les équipes dédiées à la technologie et, surtout, à construire les infrastructures nécessaires. Le géant des réseaux sociaux et de la publicité en ligne va construire un centre de données « si grand qu’il couvrirait une partie importante de Manhattan », a indiqué le dirigeant. Autres textes liés à l'intelligence artificielle :
• Bienvenue à l’ère du techno-fascisme.
• Stargate, le projet titanesque des États-Unis.
• Ce qu’il faut savoir sur DeepSeek, le «chatbot» chinois qui rivalise avec ChatGPT.
• DeepSeek et la course à l’IA, ou le capitalisme chinois contre les GAFAM.
• Les restrictions américaines derrière le succès de DeepSeek?
• Paul McCartney et Elton John plaident pour la protection des artistes contre l’IA.
• « Faux Brad Pitt » : l’escroquerie sentimentale se réinvente grâce à l’IA.
• L’intelligence artificielle pour dépister le cancer du sein, grâce à un chercheur uqamien.
• Interdiction de l’application : Qui pour acheter TikTok aux États-Unis ?
|
|
|
| |
Le Québec compte 377 médecins de plus en un an, dont une majorité de spécialistes
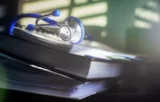
|
|
Le nombre de médecins continue de croître au Québec, et on compte deux fois plus de nouveaux spécialistes que de médecins de famille. Globalement, on retrouve 377 médecins en exercice de plus dans la province qu’au 31 décembre 2023, rapporte La Presse canadienne. Les plus récentes données sur les effectifs médicaux du Collège des médecins du Québec (CMQ), publiées mardi, font état de 26 396 médecins inscrits au tableau de l’ordre en date du 31 décembre 2024. Sur quatre ans, il s’agit d’une augmentation de 1821 médecins. La région de l’Abitibi-Témiscamingue est celle qui a vu le plus de médecins déserter, soit six médecins de famille, un spécialiste et cinq médecins avec un permis restrictif. Les endroits ayant fait le plus de gains d’effectifs médicaux sont Montréal (183 médecins), la Montérégie (70 médecins), la Capitale-Nationale (54 médecins) et les Laurentides (30 médecins). La gent féminine continue d’être plus nombreuse dans la profession médicale. Sur les 377 nouveaux médecins, 305 sont des femmes. Proportionnellement, on retrouve 55 % de femmes et 45 % d’hommes qui exercent la médecine au Québec. Autres textes liés à la santé :
• Mettre fin à l’exode des médecins vers le secteur privé : plan d’urgence de la CSN.
• Chaleur extrême : Une facture salée à venir pour le réseau de la santé, prévient l’INRS.
• Christian Dubé lâche du lest sur les compressions en santé.
• Soutien à domicile : Victimes des coupes.
|
|
|
| |
Permis fermés au Canada : Amnistie internationale dénonce les conditions de travail des migrants
|
| |
Derrière les casques de construction : Un milieu qui se féminise, sans climat féministe

|
|
Remarques désobligeantes et mentalités arriérées sont monnaie courante pour les travailleuses de la construction. Ces défis, intrinsèquement liés à leur genre, s’ajoutent au rappel constant que leur identité de femme prévaut sur leur rôle de professionnelle sur les chantiers, rapporte Montréal Campus. « Te faire regarder comme si tu es un morceau de viande, c’est tous les jours, peu importe de quoi tu as l’air », témoigne Mélanie Guevremont, directrice de chantier et de production. Isabelle Bissonnette, poseuse de systèmes intérieurs, a déjà envisagé de lâcher la construction à cause d’un compagnon. « Tu ne seras jamais assez bonne, jamais assez forte, jamais assez compétente », lui crachait-il en plein visage. « Il a été un enfer dans ma carrière », déclare Mme Bissonnette. Dans ce genre de situation, elle remarque qu’il est rare qu’on vienne l’aider, elle doit se débrouiller toute seule. En 2023, 7470 travailleuses étaient présentes sur les chantiers, soit une augmentation de plus de 250 depuis 2022, selon la Commission de la construction du Québec. Malgré cette progression, peu importe leur âge et leur spécialisation, ces femmes font face à des obstacles similaires, souvent liés à leur genre ou à des collègues masculins.
|
|
|
| |
Violence sexuelle : Près d'un agresseur sur trois serait mineur

|
|
Au Québec, les adolescents commettent plus d’infractions sexuelles que tout autre groupe d’âge. À eux seuls, ils représentent près du tiers des agresseurs présumés. Qui sont-ils ? Et surtout, que fait-on pour éviter qu’ils récidivent ? Un dossier de Léa Carrier dans La Presse. « Même avant d’embrasser une fille, je vais lui demander son consentement », atteste Émile. S’il juge bon de faire cette précision, c’est qu’il en connaît peu qui prendraient la même précaution. « Mes chums s’en foutent », souligne crûment le jeune homme, calé dans le fauteuil de son salon. L’importance du consentement, Émile l’a réalisée en complétant, il y a plusieurs années, le programme pour les adolescents ayant commis des infractions sexuelles (PACIS). Élaboré il y a près de 20 ans au Saguenay–Lac-Saint-Jean, le PACIS est depuis déployé dans la grande majorité des régions du Québec. Son objectif : réduire le risque de récidive chez les jeunes contrevenants. • « Je n’étais plus un humain » : ces hommes brisés par la violence sexuelle.
|
|
|
| |
Les gardiennes d’espoir pour les femmes violentées ont 50 ans

|
|
Les refuges pour femmes victimes de violence existent depuis 50 ans au Québec, rapporte Le Devoir. Depuis un demi-siècle, elles sont les « gardiennes de l’espoir », a déclaré Marie-Christine Plante, la directrice générale de Carrefour pour Elle, la première maison d’hébergement à ouvrir ses portes le 6 janvier 1975, à Longueuil. La Fédération des maisons d’hébergement pour femmes souligne, dans une lettre ouverte transmise aux médias cette semaine, que 1975 marque un jalon historique pour la société et pour les luttes féministes au Québec. Dans les années 1970, les femmes victimes de violence conjugale sont souvent rejetées par leur entourage et contraintes de vivre dans la pauvreté, rappelle tristement le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale sur son site Web. « En effet, le divorce est très mal vu et condamné par l’Église, et les possibilités d’autonomie économique pour les femmes sont presque nulles. Une femme divorcée est catégorisée comme une femme de mauvaise vie. » Une porte s’ouvre pour elles avec la fondation du Carrefour pour Elle de Longueuil, suivi d’un autre refuge à Montréal la même année et de cinq nouvelles maisons d’hébergement en 1976. Il y en a désormais plus d’une centaine, souligne Mme Plante en entrevue. Autres textes liés à la violence conjugale :
• «On m’a abandonnée»: des victimes de violence conjugale dénoncent les délais de l’IVAC.
• Les refuges n’y arrivent plus sans « argent neuf » du gouvernement.
|
|
|
| |
Itinérance : Montréal accuse Legault de fermer les yeux sur une crise humanitaire

|
|
Le premier ministre François Legault ferme les yeux sur la « crise humanitaire » vécue par les itinérants dans les rues de Montréal, ce qui oblige la Ville à agir à la place du gouvernement pour éviter que des gens meurent en étant forcés de dormir dehors, dénonce la mairesse Valérie Plante. En annonçant l’ouverture d’une deuxième halte-chaleur, lundi, Mme Plante a accusé les élus provinciaux, ceux du gouvernement comme ceux des autres partis, d’« abandonner les Montréalais », qui doivent côtoyer de plus en plus de personnes en détresse, rapporte La Presse. « J’ai vu François Legault débarquer avec ses bottes quand il y a eu des inondations à Baie-Saint-Paul, quand il y a eu des incendies de forêt, pour rassurer les gens », a rappelé la mairesse, acerbe, en conférence de presse. « Il est censé être un bon père de famille. Comment ça se fait qu’on ne l’a pas vu, ni personne de son équipe, au campement de la rue Notre-Dame, ni dans les refuges pleins à craquer, dans le Village, où les résidents se plaignent de plus en plus de l’insécurité ? Ou dans les conseils d’arrondissement de Ville-Marie, quand les citoyens viennent dire qu’ils sont à boutte de trouver des seringues dans leurs ruelles ? » Autres textes liés au logement et à l'itinérance :
• Itinérance : Des élus provinciaux répliquent aux propos de la mairesse Plante.
• Montréal bannit les locations de type Airbnb, sauf durant l’été.
• Logements modulaires : Montréal pourra finalement loger 90 personnes itinérantes.
• Pourquoi l’itinérance est-elle en hausse à Longueuil?
• Immobilier à Montréal: Des projets sur la voie rapide.
|
|
|
| |
L’horloge de l’apocalypse continue d’avancer

|
|
Sous le coup des menaces combinées du réchauffement climatique, de conflits armés, des armes nucléaires, des risques sanitaires et des impacts de l’intelligence artificielle, l’humanité n’a jamais été aussi près d’une « catastrophe » planétaire, préviennent les scientifiques du Bulletin of the Atomic Scientists, rapporte Le Devoir. Ces derniers ont annoncé mardi qu’ils avancent « l’horloge de l’apocalypse » d’une seconde supplémentaire cette année. L’aiguille se situe maintenant à 89 secondes de minuit, soit le plus près de la fin du monde jamais enregistré depuis la création de cette « horloge », en 1947. L’horloge avait été modifiée pour la dernière fois en 2023. Elle avait alors été avancée de 10 secondes pour s’établir à minuit moins 90 secondes, après l’invasion en février 2022 de l’Ukraine par la Russie, dotée de l’arme nucléaire. « L’heure de l’horloge pour 2025 indique que le monde est sur la voie d’un risque sans précédent, et la poursuite dans cette voie est une forme de folie », résume le Bulletin of the Atomic Scientists Science and Security Board (SASB), qui collabore notamment avec des lauréats du prix Nobel pour fixer l’heure de cette horloge symbolique. Autres textes liés à l'environnement :
• Les menaces de Trump ressusciteront-elles GNL Québec et le pipeline Énergie Est?
• Des ONG appellent à ne pas reculer sur le climat avec l’arrivée de Trump.
• Québec exhorté par ses experts à garder le cap contre la crise climatique.
• Milieux humides: La Fondation Rivières dénonce un assouplissement des règles.
• L’énergie solaire a supplanté pour la première fois le charbon dans l’UE en 2024.
• La chaleur pourrait faire des millions de morts en Europe.
• Les changements climatiques pourraient augmenter le risque de maladies zoonotiques.
• Incendies de forêt : Les Californiens pourraient poursuivre les compagnies pétrolières.
• Quand l’industrie fossile tente d’échapper à sa responsabilité.
• Étude de Québec Net Positif : Plus de 50 % des entreprises touchées par les aléas climatiques.
• Une étude craint une « extinction non documentée » des saumons.
• Financement fédéral du transport collectif : Québec et Montréal les mains vides?
• Comment arrêter le « désastre écologique » de la mer Morte ?
• Des groupes citoyens demandent un examen du BAPE sur la filière éolienne.
• Véhicules électriques : Québec pourrait reculer sur ses cibles.
• Changements climatiques : Lutter, envers et contre Trump.
• Phoque cherche banquise.
• L’actualité verte de la semaine.
|
|
|
| |
Léa Clermont-Dion : Chercheuse, autrice, scénariste et réalisatrice
|
| |
Étienne Levac contribue aux séjours d’études à Manawan et en Amazonie
|
| |
Donald Trump, le bonapartiste expliqué par André Lamoureux
|
| |
Christophe Cloutier-Roy explique les décrets signés par Donald Trump
|
Depuis son entrée en fonction le 20 janvier dernier, le président américain, Donald Trump, multiplie les décrets sur une foule de sujets : immigration, justice, économie, identité de genre, environnement. Quelle est la portée de ces décrets et comment vont-ils façonner la vie politique aux États-Unis ? Un décret est « une extension du pouvoir exécutif du président », explique Christophe Cloutier-Roy, chargé de cours et directeur adjoint de l’Observatoire sur les États-Unis de la Chaire Raoul-Dandurand, au Devoir. « Dans sa définition la plus simple, un décret, c’est une consigne que donne le président à tout ce qui relève du pouvoir exécutif : fonctionnaires, militaires, bref tout ce qui relève du gouvernement fédéral. » Les décrets présidentiels n’ont pas force de loi. Ils peuvent être soumis au jugement des tribunaux et infirmés s’ils ne respectent par les principes de la Constitution américaine.
|
|
|
| |
Première semaine de la présidence de Donald Trump analysée par Rafael Jacob
|
| |
Julien Tourreille commente l'accord entre Trump et la Colombie
|
| |
Le regard de Pierre Duchesne sur la nouvelle session à Québec
|
| |
Les vêtements en duvet ne sont pas synonymes de cruauté animale, selon Madeleine Goubau
|
|